
Roger Huet
Roger Huet - Chroniqueur vins et Président du Club des Joyeux
Québécois d’origine sud-américaine, Roger Huet apporte au monde du vin sa grande curiosité et son esprit de fête. Ancien avocat, diplômé en sciences politiques et en sociologie, amoureux d’histoire, auteur de nombreux ouvrages, diplomate, éditeur. Il considère la vie comme un voyage, de la naissance à la mort. Un voyage où chaque jour heureux est un gain, chaque jour malheureux un gâchis. Lire la suite...
La 30e édition de «Une dégustation de vins d’Italie»
Le salon de vins le plus beau et le plus gourmand, celui que tous les professionnels du vin attendent impatiemment à Montréal est sans aucun doute celui de la Délégation commerciale d’Italie connu comme "Une dégustation de vins d'Italie". Il a eu lieu le 5 novembre dans l’édifice historique du Marché Bonsecours, et a réuni quatre-vingt-treize producteurs vinicoles d'Italie qui se sont déplacés expressément pour venir rencontrer leurs clients et amis du monde de la gastronomie. Ils ont aussi apporté leurs meilleures bouteilles à déguster et leurs nouveaux produits pour nous les faire découvrir.
À la programmation il y avait tout d’abord une classe de maître intitulée Bons, Durables et Équitables : l’art du vin lent en Italie. Elle était présentée par Jonathan Gebser, Vice-curateur du Slow-Wine, avec la collaboration de la Master of Wine Jacky Blisson.
Nous avons découvert ainsi toute l’histoire du Slow Wine qui a été inventé en Italie. En 1982 les Amis du Barolo fondent ce que deviendra plus tard le Slow Wine. Ce qu’ils souhaitent c’est un autocontrôle pour que le vin soit fait sans ajouts inutiles de produits chimiques, en respectant la terre, la vigne et le vin, pour le bien de la santé des consommateurs. En 1982 éclate de scandale du méthanol que certains vignerons utilisent comme agent de conservation, ce qui réconforte les Amis du Barolo dans leur action. En 1988 est publiée pour la première fois le Guide du Gambero Rosso des Vins d’Italie. En 1992 voit le jour le premier numéro du Guide des vins quotidiens et en 2004 est fondée la première banque du vin, pour conserver la mémoire du vin italien.
Entre 2007 et 2009 les vignerons d’Europe établissent les défis pour le vin de l’avenir. Deux-mille onze voit la publication du Guide du Slow Wine. En 2012 le guide comprend l’Europe, le Japon et le Canada. Entre 2017 et 2022 il conquiert la Slovénie, les États-Unis et la Chine.
En 2020 est signé à Bologne, le Manifeste du Slow Wine, pour un vin bon et propre.
La Classe de maître s’est terminée par une dégustation de vins Blancs, rosés et rouges produits dans les règles du Slow wine qui étaient beaux à regarder, d’agréables arômes et savoureux et rassurants en bouche. Leur provenance était le Haut Adige, la Vénétie, la Toscane, la Sicile et le Piémont.
Entre les changements climatiques et la concurrence féroce qui existe dans le marché mondial du vin, il semble assuré que la voie du succès à l’avenir sera celle des vins lents, faits avec patience et avec amour.
Il était alors près de midi et les deux grands salons du Marché Bonsecours commençaient à s’animer. Les vignerons italiens et leurs agents étaient installés, une foule de professionnels du vin commençait à remplir les salles; le bruit des verres venait égailler nos oreilles. Les tables de bons produits de bouche italiens qui font la réputation de ce salon étaient déjà en place. La fête du vin italien a pris toute sa couleur. Les bouteilles des vins du Piémont étaient partout suivies de près par celles du Chianti et de la Sicile. La Sicile qui autrefois était connue pour ses vins capiteux et à haute teneur en alcool, a commencé il y a quelques années à surveiller sa production de vin en réduisant la chaleur ambiante. Les récoltes se font maintenant de nuit, jusqu’au petit matin, le raisin arrivé au chai est dorénavant mis dans des chambres froides. Tout le processus de production : pressurage, vinification et vieillissement se fait à température contrôlée, et le résultat donne des vins siciliens de qualité, très appréciés des consommateurs. Appuyés par un marketing intelligent, les Siciliens réussissent très bien dans le marché international du vin.
En 2025 les 17 régions vinicoles d’Italie étaient honnêtement représentées dans Une dégustation des vins d’Italie, sauf une dont les bouteilles étaient introuvables, et c’était la Lombardie.
J’ai fait deux tours complets des deux grands salons pour enfin dénicher une table de Franciacorta, de la marque Ferghettina représentée par L’Enoteca di Moreno de Marchi. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.lenoteca.ca
Le Franciacorta est l’équivalent du champagne français, sa fabrication demande au minimum 2 ans et 3 mois de travail soigneux et une double fermentation. C’est un vin pétillant fantastique, vendu à 50% du prix d’un champagne courant, et à peine le double que son rival italien, le Prosecco, qui est fabriqué en 40 jours.
La SAQ liste 87 vins de Lombardie, tous des vins tranquilles de qualité. Pourquoi ne sont-ils jamais présentés dans les Salons de vins? Pourquoi la Lombardie ne figure jamais comme région vedette dans aucun salon de vin? Parce que les vignerons lombards ne reçoivent aucun support de leur gouvernement régional. Quel dommage!
Parcourir les allées de ce grand salon est un rêve pour tout amateur de vins de qualité. Je vais vous parler d’abord des vins qui m’ont le plus impressionné, des vins parfaits. Je me réfère aux Amarone de Cantina Monteci, propriété de la famille Righetti, le roi des vins de Valpolicella. Ils ont un important patrimoine agricole de 200 hectares dans les meilleures zones de la Vénétie, particulièrement dans la Valpolicella classique où sont produits les plus prestigieux vins Amarone et de Ripasso. Leur philosophie tient en deux règles cardinales : La première est la production de grappes de grande qualité qui commence dans la gestion du vignoble et une stricte sélection des grappes récoltées qui vont donner un superbe moût avec des arômes exceptionnels. La deuxième règle concerne la gestion du chai, où le protocole de vinification est supporté par une technologie de pointe. La passion, la connaissance, le talent de chacun des acteurs jouent un rôle important dans le travail quotidien pour chaque geste qui conduit à la fabrication de chaque vin de cette incroyable maison. La cantina Monteci a la certification Vegan depuis 2019, la Certification SQNPI, la certification RRR, la certification 100% énergie propre et la certification 100% libre de CO2. Leurs vins sont 100% organiques, produits dans un environnement 100% propre.
Francesco Righetti œnologue de Cantina Monteci avec Jean-François Gendron son agent pour le Québec. Crédit Roger Huet
La Maison Monteci célèbre son premier centenaire cette année 2025.
Les cépages autorisés pour la production d'Amarone sont la Corvina, le Corvinone, la Rondinella et, en plus faible proportion, la Molinara. Lorsque les raisins sont bien mûrs, les vendanges sont effectuées manuellement : les grappes sont délicatement placées dans de petites caisses afin de les maintenir compactes pour préserver leur intégrité. Les raisins sont transportés au séchoir, un espace vaste et aéré à faible humidité. Dans cette atmosphère paisible, s’opère le passerillage qui est une forme de séchage du raisin, une technique utilisée depuis l'Antiquité, essentielle à la production de l'Amarone. Cette phase dure une centaine de jours minimum, et permet au raisin de concentrer sa substance et de s'enrichir en sucres qui conféreront au vin corps et structure.
Des raisins séchés, est extrait un nectar précieux qui, après fermentation, vieillit dans de nobles fûts de chêne français. Le passage en fût développe des arômes nouveaux et complexes qui forment un riche bouquet de fruits rouges mûrs, d'épices, de bois et de tabac, avec une légère note balsamique. L’Amarone Classico della Valpolicella DOCG Monteci est le fruit de tous ces éléments. Une bouteille d'Amarone, renferme le pouvoir du temps.
J’ai dégusté deux vins exceptionnels : Tout d’abord le Monteci Amarone Della Valpolicella Classico DOC, fait de Corvina, Corvinone, Rondinella et Oseleta.
La Vinification commence par le passerillage pendant environ quatre mois ; fermentation en partie en cuves d'acier et en partie en cuves de chêne. Le vin est ensuite élevé initialement en barriques et tonneaux pendant 24 mois, et poursuit ensuite son vieillissement en grands fûts.
La mise en bouteille se fait 48 mois après la récolte.

En bouche c’est un vin puissant, ample, intense, velouté, où on retrouve les arômes perçus au nez, avec une finale longue et persistante.
C’est un vin de gastronomie qui se marie très bien avec le gibier en général, parfait avec les viandes braisées et avec les rôtis. Il est délicieux avec le risotto à l’Amarone et avec les fromages affinés. Je suggère de le servir à 18 degrés Celsius.
J’ai dégusté ensuite, le Monteci Costa Delle Corone Amarone Classico della Valpolicella DOC. Cépages: Corvina, Corvinone et Rondinella. C’est le plus grand vin de la maison, sa plus parfaite expression de l’identité de Monteci, et la synthèse d’un vignoble qui porte aussi le nom de Monteci et qui est presqu’inaccessible sur les hauteurs de la Valpolicella classica.
Le raisin subit d’abord un long passerillage de près de 5 mois. Après le pressurage, le moût et les peaux restent en contact pendant 30 jours, suivis de la fermentation alcoolique naturelle et de la fermentation malolactique. La fermentation se déroule en partie en cuves inox et en partie en cuves de chêne.
Un long élevage en fûts de chêne de 50 HL pendant 60 mois, donne naissance à ce vin majestueux. Il repose ensuite longuement en bouteille avant d’être mis au marché.
Robe rouge rubis aux reflets grenat. Arômes d’épices, de confiture de cerises, d’amande et de fruits rouges. Notes subtiles de cuir et de tabac.
En bouche c’est un vin intense et persistant, complexe, onctueux et veloutée, avec des tanins très élégants et un parfait équilibre de toutes ses composantes. Il coule harmonieux et caressant jusqu’en fin de bouche qui est longue, gourmande et qui appelle une autre gorgée pour renouveler son plaisir.
Il est certain que ce vin appelle les viandes et les mets longuement mijotés, mais il est magique au point qu’il va sublimer n’importe quel mets. Il sort tellement des sentiers battus qu’il a le pouvoir de vous sublimer vous-même si vous le dégustez en silence, en le méditant, par exemple, devant un paysage d’automne.
Il faut le servir à 18 degrés et surtout ne pas se dépêcher à le boire, pour découvrir toute sa richesse.
Le MONTECI COSTA DELLE CORONE AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA DOC, est uniquement en importation privée. Ce bijou qui demande tant de soins avant d’être commercialisée ne coûte qu’un peu plus de 100 dollars et il n’a été tiré qu’à 5000 bouteilles. Profitez-en car il n’a pas été créé pour faire des profits, il a été fait pour prouver que l’Amarone Classico, lorsqu’il est fait dans les règles du grand art, c’est le plus grand vin italien.
Vous pouvez contacter son agent : Jean-François Grendron chez Héritage Tel. (514)916-9113 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.lheritagevins.com; www.monteci.it
Dans mes déambulations je me suis arrêté à la table de la Société Agricole Garesio, qui est une société familiale de 25 hectares de vignes, entre le Langue et Monferrato, dirigée par Giovanna Garesio.
Giovana Garesio avec son Barolo Cerretta. Crédit Roger Huet
Depuis 2010, les Garesio cultivent directement des vignobles prestigieux à Serralunga d'Alba, au cœur de la dénomination Barolo, à Incisa Scapaccino et Castelnuovo Calcca, situés dans le Monferrato, propices à la production de Nizza et de Barbera d'Asti ; et à Peletto, dans la région d'Alta Langa, où est produit le Metodo Classico Alta Langa.
Chez Garesio la vocation c’est la création de vins élégants, bien équilibrés et qui expriment pleinement le terroir et le fruit. Les vignobles sont cultivés avec des techniques agricoles durables dans le respect de la nature et des hommes. Le Nebbiolo est certifié biologique. Au chai Garesio applique le style de vinification traditionnelle qui adopte les meilleures technologies pour préserver la pureté du raisin dans chaque vin.
J’ai dégusté le Garesio Barolo DOCG Cerretta 2019, 100% Nebbiolo.
Vendanges manuelles en octobre. Sélection minutieuse des raisins au chai. Fermentation et macération pendant environ 40 jours, pompage et délestage, les 20 derniers jours avec un bouchon immergé.
Vieillissement du vin dans des fûts en chêne autrichien de 25, 35, 40 ou 50 hl, pendant 18 à 30 mois. Affinement supplémentaire dans la bouteille avant la mise en marché
Robe rouge grenat de moyenne intensité. Bouquet de fruits rouges (fraise, framboise, groseille), de fleurs (violette et rose blanche), de poivre blanc, de chocolat, de tabac; une note fumée et un soupçon de réglisse.
En bouche c’est un vin puissant, tannique mais à la fois velouté et élégant, avec une belle acidité. On y retrouve les riches arômes perçus au nez. Un vin qui a une bonne longueur et qui demeure gourmand jusqu’au bout.
Ce Barolo se marie très bien avec les viandes rouges, sous toutes ses formes; il est magnifique avec des mijotés aux champignons et avec des sauces au fromage et noisettes.
Je suggère de le servir à 18 degrés Celsius et le laisser reposer en carafe environ une heure.
Pour les disponibilités en IP, contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Il était presqu’impossible ne pas s’arrêter à la table de la Cantina de Fabio Cordella, le concepteur du « Vin des Champions ».
Fabio Cordella et ses vins crédit Roger Huet
Fabio Cordella est né à Bari en 1975 dans une famille de vignerons de prestige. Il a été un grand joueur de football dans sa jeunesse dont la carrière a été interrompue par une erreur médicale. Alors il est devenu directeur sportif de nombreux clubs avant de prendre en main l’entreprise viti-vinicole familiale qu’il a propulsée dans plusieurs régions vinicoles célèbres d’Italie, comme la Vénétie où il produit l’Amarone della Valpolicella DOCG, la Toscane où il élabore le Brunello di Montalcino DOCG et les Pouilles (Salento) où il vinifie un rosé d’assemblage de Primitivo, de Negroamaro et de Chardonnay.
Pour joindre l’utile à l’agréable il a lancé le Vin des Champions alliant les excellents vins que son domaine produit avec des footballeurs légendaires en éditions limitées. Chaque bouteille est étiquetée à leur nom et numéro, comme Ronaldinho pour un Amarone della Valpolicella, Wesley Sneijder pour un Brunello di Montalcino, Roberto Carlos pour un Nero d'Avola, Ivan Zamorano pour un autre Brunello di Montalcino « El Gran Capitán » et Gianluigi Buffon pour un Primitivo Salento IGT. Vous pouvez consulter la liste des Vins des Champions : Fabio Cordella | Les Champions.
J’ai dégusté le Fabio Cordella, Primitivo Salento IGP 1975.
Robe rouge intense avec des reflets violets. Bouquet riche de fruits noirs : (cerise, prune, mûre), herbes de Provence, un peu de poivre et d’origan, olive noire, des notes boisées et vanillées.
Ample en bouche, avec une texture veloutée et souple, des tanins élégants, avec une certaine fraîcheur très agréable, et un degré d'alcool de 15 %. C’est un vin charmeur avec une bonne longueur en bouche.
Ce Primitivo est un vin d’accompagnement privilégié pour les viandes grillées, agréable avec les pâtes en sauce comme les ravioles, superbe avec les pizzas napolitaines.
Actuellement la SAQ ne détient, dans Cellier, que la bouteille de Fabio Cordella Cantine Wesley Sneijder Amarone della Valpolicella 2016 code 14320283. Prix 91,75 $
Pour plus d’information sur les IP vous pouvez écrire à Fabio : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Tout le charme de « Une dégustation de vins d’Italie » réside dans la possibilité de rencontrer des confrères connaisseurs, de s’arrêter souvent pour tester des vins, pour manger quelques délicieuses bouchées, et continuer notre déambulation à travers les allées, pleines de tables remplies de superbes bouteilles. Je me suis arrêté à la table de l’entreprise familiale Il Conte Villa Prandone.
Le domaine vinicole d’Il Conte Villa Prandone se trouve au cœur de la région de Piceno, sur les collines du village médiéval de Monteprandone. Les vignes sont sous l’influence des brises de l’Adriatique et des courants des montagnes Sibyllines. Avec le sol argileux c’est un terroir d’exception où la famille De Angelis cultive des raisins indigènes de la région des Marches, comme le Pecorino, la Passerine, le Montepulciano, et le Sangiovese, avec lesquels ils produisent une gamme magnifique de vins blancs, rosés et rouges.
C’est dommage que le seul vin disponible à la SAQ Cellier de cette maison, soit Il Conte Villa Prandone Marinus DOP Rosso Piceno Superiore 2020. Cépages : Montepulciano 70 %, Sangiovese 30 %, degré d'alcool 14 %, Taux de sucre 8,4 g/L. Code SAQ 14727737. Prix 29,80 $
Je l’ai dégusté. La robe est rouge violet. Un bouquet complexe intense de fruits rouges (framboise, cerise) et noirs (mûre, myrtille) mais aussi des notes de réglisse et de chocolat. On perçoit aussi de subtiles notes boisées et épicées.
Bouche ferme, généreuse, avec les fruits noirs dominants. Sec, corsé, équilibré, une belle acidité et une finale longue et très plaisante.
C’est un vin de gastronomie qui aime l’agneau sous toutes ses formes, et les viandes rouges et les pâtes en sauce de tomate. Agréable également avec les fromages à pâte dure. Il faut le servir à 18 degrés Celsius. Ce vin peut se conserver jusqu’à 10 ans en cave.
Comme ils produisent une très belle gamme de vins, pour les importations privées je vous suggère de contacter le producteur :
Il Conte Villa Prandone Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.ilcontevini.it
Un peu plus loin j’ai eu la joie de rencontrer mon ami Jacques Bélec, Vice-Président de développement des affaires de l’Agence Montalvin, et un des meilleurs agents que je connaisse. Il m’a fait découvrir le Vallepicciola Chianti Classico DOCG 2023. Sangiovese 100%.
Robe rouge rubis typique de la variété. Arômes floraux et fruités: baies de sous-bois, groseille, framboise, mûre, abricot, confiture, violette poivrée.
En bouche c’est un vin charpenté, robuste et à la fois souple et équilibré, riche en alcool, avec une bonne fraicheur. Tannique mais élégant. Très long et fruité en fin de bouche.
Ce Vallepicciola Chianti Classico DOCG 2023 est disponible à la SAQ, code 15465003. Prix 22.75 $. Pour plus d’information vous pouvez consulter www.montalvin.com
Je me suis arrêté ensuite à la table de la Fattoria Montecchio de Florence car elle a une histoire passionnante. Au XIIIe siècle la famille Torrigiani, originaire de Florence, possédait la Fattoria Montecchio et fabriquait de la soie. Les Torrigiani se sont enrichis exportant leurs produits dans toute l’Europe. Au fil des ans les Torrigiani ont occupé des postes importants dans le gouvernement de la cite de Florence et au Seizième siècle ils sont devenus vraiment très puissants car ils ont eu la sagesse de rester en dehors des conflits qui opposaient les Médicis aux aristocrates de la ville. En 1520, ils achètent le premier palais de la ville, le Palazzo Bartolini Torrigiani, premier d’une longue série et le début d’une histoire qui culminerait avec l’attribution du titre de marquis à Giovanni Vincenzo Torrigiani, sous le règne du pape Clément XIII. C’est avec leur anoblissement qu’ils commencent à produire du vin.
Pour le Chianti Classico et pour son cépage de base le Sangiovese, le processus de vieillissement en fûts de bois est crucial. À la Fattoria Montecchio, ce procédé est identique à celui d’il y a 400 ans et la refermentation de style Chianti, se fait strictement en fûts de chêne.
En 1973, l’entrepreneur toscan Ivo Nuti, importante figure dans l’industrie du cuir à Santa Croce sull’Arno acquiert la propriété. Il choisit de se consacrer à la viticulture en Toscane, et donne une nouvelle impulsion au domaine.
Aujourd’hui, la société est enregistrée sous le nom Fattoria Montecchio Società Agricola a Responsabilità Limitata, et son directeur général est Riccardo Nuti.
Dans les années 1980 la propriété s’enrichit d’une nouvelle cave, la Cantina Nuova qui est l’endroit où se déroulent les premières étapes de la production du vin, à commencer par la vinification dans des cuves en acier inoxydable. Le vin est ensuite transporté sous terre, à La Comola, sous les grandes cuisines de la maison principale, qui abrite des fûts de chêne de 25 hectolitres et des barriques, où vieillissent les vins Chianti Classico et Riserva.
Le reste des vins produits par la Fattoria Montecchio vieillit dans la Barricaia, une cave à plafond voûté entièrement en brique. Un autre espace, très similaire à la Barricaia, abrite l’Anforaia, où sont stockées des amphores en terre cuite où vieillissement les grands vins. L’Anforaia abrite également des grands tonneaux en chêne de 33 hectolitres ainsi que d’autres barriques.
Une fois embouteillé, le vin retourne à la Cantina Nuova pour être stocké, avant d’être mis sur le marché.
La Fattoria Montecchio, possède aussi un Museo del Vino où ils conservent des centaines de bouteilles de chaque millésime, depuis les années 1960.
J’ai dégusté le Fattoria Montecchio Chianti Classico Grand Selezione DOCG 2019. Une édition limitée à 6900 bouteilles, 100% Sangiovese
Ce vin a vieilli 30 mois, moitié en fûts, moitié en amphores de terre cuite. Il titre 14% d’alcool.
Robe rouge intense avec des reflets bruns. Riche bouquet de Violette, baies de sous-bois, groseille, framboise, mûre, cerise marasquin et prune, avec des notes épicées.
La bouche est intense et persistante, élégante et complexe, robuste et souple, avec des tanins ronds. Long et fruité en fin de bouche.
Ce vin de gastronomie est idéal avec les plats à base de viande rouge, de gibier, de champignons et de truffes. Il a une capacité de garde de 25 ans.
Les vins de cette maison sont vendus seulement en IP. Contacter l’agent : www.leantowines.com ou le producteur Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Les coopératives font parfois de très bons vins et toujours à des prix raisonnables. Je me suis arrêté à la table de Produttori di Govone Soc. Coop. Agricola parce qu’ils avaient des vins des Langhe très tentants. Les Langhe se trouvent dans la partie méridionale du Piémont.
Le domaine Produttori Di Govone, fondé en 1957, compte aujourd'hui environ 250 membres. Véritable expression du terroir, il est le point de rencontre des régions viticoles de Langhe, Roero et Monferrato.
J’ai dégusté leur GOVONE DOLCETTO DOC LANGUE, 100% Dolcetto, 14% d’alcool, Vinifié en cuves inox.
Robe violacée, aux arômes de fruits noirs, d’amande amère et de réglisse.
En bouche c’est un vin sec, avec des tanins ronds et souples; son acidité est faible, mais sa masse fruitée est très agréable; à boire jeune.
À table le Dolcetto s’accorde bien avec la cuisine italienne : les charcuteries, les pizzas, les pâtes, les viandes rouges ou blanches grillées, le risotto à la tomate ou aux asperges et les multiples fromages italiens. Il faut le servir à 16 degrés Celsius.
Les vins de Govone sont uniquement disponibles en IP. Contactez son agent : BLANC OU ROUGE : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel. 450 747-3070 poste 108
J’ai voulu terminer ma promenade gustative avec un Barbaresco et j’ai choisi les vins de la Casa Vinicola Fratelli Casetta, qui revendique des racines à Roero jusqu’en 1725.
J’ai dégusté leur magnifique Casetta Barbaresco DOCG 2019 fait à partir de raisins Nebbiolo cultivés dans les vignobles du domaine avec un sol de composition calcaire et marneuse, où ils reçoivent les meilleures conditions pour donner la concentration maximale des raisins. Après la fermentation en acier inoxydable, le vin a été élevé en grands fûts de chêne slavon pendant 4 ans et un an supplémentaire en bouteilles. Il n'y a ni filtrage ni collage avant la mise en bouteille.
Belle robe couleur rouge grenat. Bouquet complexe de fruits rouges, de tabac, de poivre, d’épices, un peu de réglisse, de fleurs d’iris, et de violette.
En bouche c’est un bonheur, ample, généreux, fruité, épicé avec la juste dose d’acidité, des tanins magnifiques élégants et soyeux, et une longue persistance en bouche. Un vin caressant jusqu’à la toute fin.
Ce Barbaresco à table c’est un seigneur. Il accompagne les viandes rouges majestueusement, il est superbe avec toute la grande cuisine italienne. Il faut le déguster comme il se doit, et ne jamais le boire trop vite. On doit le servir à 18 degrés Celsius. C’est un vin de longue conservation en cave. Je me demande ce qu’il doit être le Casetta Barbaresco Riserva DOCG 2004… la perfection!
Il semble que la SAQ ne les tient pas mais ils ont un bon agent pour les IP : ivsp, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Comme chaque année, je me promets de poursuivre ma quête des grands vins italiens l’année prochaine!
Cette année la Délégation Commerciale d’Italie (ICE) célèbre la 30e édition de « UNE DÉGUSTATION DE VINS D’ITALIE » Je tiens à rendre hommage à tous ses acteurs qui patiemment, avec une persévérance, et une intelligence sans pareil ont réussi à faire la promotion des vins d’Italie, comme aucun autre pays. L’Italie c’est aujourd’hui le premier pays exportateur de vins au Canada et au Québec, suivi de loin par la France. Il y a deux personnes qui méritent une reconnaissance spéciale pour avoir permis aux Agences de vins de faire connaître et aimer leurs produits italiens, il s’agit de Fausta Mallozi et Emanuele Giusti. Un grand merci à eux de la part de tous les professionnels du monde vinicole.
Roger Huet chroniqueur vins
Brad Hickey, l’impétueux vigneron de la Vallée McLaren en Australie
J’ai rencontré Brad Hickey dans un salon de vins d’Australie à Montréal, en mai 2025. Il faisait partie d’une classe de maître avec d’autres vignerons australiens. Les Australiens sont généralement de haute taille et bien bâtis, mais Brad les surpassait d’une demie-tête, et avec ça un charisme qui captait l’attention de tous.
Nous avons dégusté ses vins qui sont disponibles à la SAQ: il y avait un CINS 2023, fait de Cinsault 100 %, un Cabernet Franc-Sand 2022, 100% Cabernet Franc et un Zibibbo 2022, fait de Zibibbo à 100 % qui est un cépage blanc de la famille des Muscats, aujourd’hui rarement cultivé en Europe, mais qui commence à être apprécié en Australie. Ce cépage blanc est travaillé par Brad comme un vin rouge. Une fois le raisin égrappé il est placé dans des amphores en terre cuite. Bientôt il s’en suit une longue fermentation en forme de chapeaux, lesquels sont plongés à la main deux fois par jour. Les peaux, les pépins et le jus restent en place pendant six mois. Une couche naturelle de levures FLOR se développe, recouvrant et protégeant le vin. Le jus de goutte est siphonné au printemps et mélangé aux pressurages. Le vin est débourbé avant d'être soutiré et mis en bouteille, non filtré ni collé. Il en résulte un merveilleux vin orange, trouble, d'une robe cuivré pâle et diaphane.
À la première gorgée, moi et les autres chroniqueurs et sommeliers nous avons été sortis de notre zone de confort et avons ouvert de grands yeux de surprise. À la deuxième gorgée nous avons trouvé ce vin orange drôlement bon et à la troisième nous le célébrions comme le meilleur des vins orange jamais goûté!
Après la classe de maître je me suis arrêté à la table de Brad Hickey et je lui ai demandé de me raconter son parcours. Brad est né à Chicago, et à son adolescence, avec la tête pleine de rêves il est allé à Paris, où il a appris le français et découvert les grand poète Charles Baudelaire qui a si bien chanté le vin. Brad connaît par cœur plusieurs de ses poèmes. Ensuite Brad s’est établi pour un temps à Portland, et après à New York où il cherchait un emploi dans la restauration. Comme il a une fière allure on l’a assigné sommelier, mais il ne savait pas ouvrir une bouteille de champagne dans les règles de l’art. Heureusement le jeune homme avait un charmant sourire qui lui faisait pardonner tout, et Brad apprend vite. Peu de temps après il décrochait un poste de sommelier dans le restaurant emblématique du chef étoilé Michelin David Bouley à Manhattan. Brad découvre alors les grands vins et devient tellement compétent qu’il est assigné à l’achat des vins pour la cave mythique de l’établissement. Il sait exactement ce que recherchent les connaisseurs et cela sera sa force pour son futur de vigneron. Bien que Brad gagne très bien sa vie et connaît le succès dans son métier, au bout de quelques années il se trouve à l’étroit à Manhattan. Il rêve de grands espaces et décide de tenter sa chance en Australie, la terre de tous les possibles et de la liberté.
 Gracieuseté de Brash Higgins
Gracieuseté de Brash Higgins
En 2007 il fait la connaissance de Nicole Thorpe à l’Alma Hôtel de McLaren Vale, dont la famille est bien connue dans cette région vinicole.
Nicole était propriétaire depuis 10 ans d’un petit vignoble, appelé Omensetter, où elle cultivait le Cabernet-Sauvignon et la Syrah. Elle expliqua à Brad que la sécheresse semblait s’y être installée dans la région pour de bon et lui faisait craindre le pire pour l’avenir de sa parcelle. Brad voulu la voir. Il constata en effet que le réchauffement climatique affectait toute la région de McLaren Vale, qui autrefois était reconnue très fertile. D’un autre côté la vigne a souvent poussé dans des régions difficiles à condition de trouver les bons cépages. Le sol argilo-calcaire de la parcelle de Nicole était intéressant et sa proximité du golfe de Saint-Vincent qui la balayait d’une brise rafraichissante était un atout. Nicole invita Brad à se joindre à elle et ensemble commencèrent à chercher des moyens de minimiser les aléas du climat.
Constatant que le Syrah et le Cabernet étaient les cépages les plus touchés par la sécheresse, le couple commença à chercher des cépages qui pourraient mieux résister à des conditions de sécheresse et de chaleur. Steve Pannell, une légende locale, fut consulté au sujet du cépage italien Nero d'Avola, réputé pour sa résistance et susceptible de bien s'adapter à la vallée McLaren.
Brad et Nicole sont partis voir de leurs yeux la culture du Nero d’Avola en Sicile. Ils y ont rencontré d'excellents producteurs qui utilisaient des amphores pour fermenter et vieillir leurs vins avec des résultats fascinants.
 Gracieuseté de Brash Higgins
Gracieuseté de Brash Higgins
À leur retour en Australie, le couple s’est mis immédiatement à greffer des boutures sur un demi-acre de leurs vignes de Syrah à Omensetter. Ils se sont mis ensuite à la recherche de quelqu’un qui puisse faire des amphores en terre-cuite. Ils ont chargé le potier John Bennett, basé à Adélaïde, de la fabrication de leurs récipients de 200 litres en terre cuite à partir de l'argile locale de l'Australie-Méridionale, très ressemblants à ceux qu'ils avaient vus en Sicile. Finalement au bout d’un long parcours, leur premier vin de Nero d'Avola fermenté en amphore a été produit dans leur domaine, sous la marque de Brash Higgins et il a reçu un accueil très favorable dans toute l’Australie.
D’autres cépages résistants à la chaleur et demandant très peu d’eau se sont ensuite ajoutés à la production, comme le Zibibbo et le Cinsault. L’engagement de Brad et de Nicole à faire des vins nature, en cultivant leur raisin avec le moins d’intervention humaine et en fabriquant leurs vins avec des ferments naturels et sans ajout de produits chimiques, leur a permis d’obtenir l’Australian Certified Organic, que le vignoble Omensetter et la micro-cave Brash Higgins ont reçus en 2017.
J’ai demandé à Brad d’où venait l’alias de Brash Higgins que porte sa cave. Il m’a répondu que c’est à cause de son caractère. Il aime que les choses avancent et il est impatient, ce qui lui a valu quelques crashs avec sa voiture. À cause de ça, ses voisins l’ont surnommé Brash, qui veut dire impétueux et qui rime avec crash.
Au moment où j’écris ces lignes je suis en train de déguster le Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault 2023, Cinsault 100 %, avec un degré d’alcool de 13,2% et un taux de sucre résiduel de 1,2 g/L ce qui fait de lui un vin sec.
Le raisin est issu d'un bloc de vignes de Cinsault qui ont été greffés sur une ancienne parcelle de Sémillon en 2013. Le Cinsault est un cépage noir à jus blanc, particulièrement apprécié pour sa souplesse et sa finesse.
Le raisin a été sélectionné à la main et placé dans une cuve de fermentation ouverte de 2 tonnes, pendant 2 semaines. Les levures sauvages ont fait leur travail. Le tout a été pressé délicatement dans un pressoir à panier et déposé dans des fûts français de 8 ans d’âge, pendant 7 mois. Le millésime 2023 est le septième de Cinsault produit par la cave Brash Higgins.
 Gracieuseté de Brash Higgins
Gracieuseté de Brash Higgins
Robe rubis. Bouquet riche de cerise, de pêche, de framboise, de groseille, de grenade, de fraise et de nectarine, avec des notes de noix de muscade et de poivre blanc.
En bouche il est à la fois vif et ample, avec un éventail d’arômes qui correspond au bouquet perçu par le nez, des tanins souples et élégants, un bel équilibre, une agréable fraîcheur et une finale longue et savoureuse.
C’est un vin qui s’accorde merveilleusement avec des mets végétariens, avec des viandes blanches et avec des fromages de chèvre.
Le Cinsault est un vin à boire jeune.
Le Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault 2023, est disponible à la SAQ, code 15175655. Prix 32,75 $ pour la bouteille de 750 ml.
Références :
Brad et Nicole seront ravis de recevoir votre visite.
Pour réserver : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Ils sont représentés au Québec par : Sélection Rezin (vins)
Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com
Les merveilleux apéritifs Finote de tradition française
J’ai été invité à Tastin’France, la 18e dégustation professionnelle itinérante de Business France qui m’a permis de découvrir cette année des producteurs de vins, de Cognacs, d’Armagnacs et de cocktails, exceptionnels. J’y ai rencontré Élodie Swanberg, qui produit des boissons sans alcool d’une qualité incroyable, dans la gamme Finote. Son art lui vient d’une longue tradition familiale. Son arrière-grand-mère qui s’appelait Joséphine Émilie et qu’on appelait familièrement, Finote, élaborait, au XIXe siècle ses propres apéritifs à partir de vin, de plantes de montagne et d’épices, dans la région d’Argelès-sur-Mer, dans la Catalogne française.

À cette époque, les temps étaient durs pour une veuve, mais Finote, à force de travail et de droiture avait réussi à créer des saveurs uniques et à atteindre un savoir-faire incomparable. Elle vendait ses produits dans la première épicerie fine à Perpignan qui appartenait à Catherine, l’autre grand-mère de la famille. De cette aventure est resté un carnet de notes où Finote a annoté soigneusement ses recettes et ses secrets de fabrication. Ce précieux carnet s’est transmis dans sa famille jusqu’à aujourd’hui.
Élodie Swanberg a eu l’heureuse idée de faire revivre les recettes de son arrière-grand-mère plus de 100 ans plus tard, en les adaptant au goût moderne. Avec l'aide d'un sommelier, d'un œnologue et d'un laboratoire de recherche et développement, elle a transformé des recettes centenaires en une nouvelle génération d'apéritifs et de boissons prêtes à boire, naturelles, complexes et sans alcool. Les produits Finote sont nés pour sublimer la tradition et définir l'avenir du zéro degré.
Elle a lancé tout d’abord deux produits, et d’autres paraîtront incessamment. Le premier est le Finote Apéritif n°1, riche, herbacé et amer, sans alcool en format de 75 cl et 25 cl.

Crédit Finote
Cette boisson à la robe sombre offre une multitude de saveurs profondes : Caramel, piment de la Jamaïque, noix, vanille, chêne fumé et même des notes de Sherry oloroso. Une boisson complexe, légèrement plus amère que sucrée, qui n'en reste pas moins onctueuse, douce et longue en bouche.
L’Apéritif No 1 est idéal pour la mixologie : une base polyvalente pour créer des créations originales et sophistiquées. À utiliser dans des cocktails sans alcool et à faible teneur en alcool : 9 à 12 portions par bouteille.
Le deuxième produit est le Finote Spritz pétillant, prêt à être dégusté : orange, gentiane, romarin. Disponible en formats de 75 cl et 25 cl.

Crédit Finote
Robe ambrée aux reflets dorés. Arômes de caramel, de thé noir, d'agrumes et d'herbes aromatiques. En bouche, il s’ouvre sur des arômes d'écorce d'orange amère, de rhubarbe et de notes grillées. Il est rafraîchissant et délicieux jusqu’en fin de bouche. À déguster bien frais dans un verre ballon, pur ou sur glace, et garni d'une tranche d'orange. Le Spritz s'accorde parfaitement avec des fruits de mer, un plateau de poisson ou un dessert aux agrumes. Disponible dans les minibars des chambres d'hôtel, les boutiques et les restaurants.
Les produits Finote sont fabriqués à partir d'ingrédients 100 % naturels et de plantes biologiques en Occitanie, dans le sud de la France.
Voici quelques cocktails délicieux à composer avec les produits Finote :
Finote Cherry Manhattan style (short drink) 5cl de Finote Apéritif No1 | 3cl de jus de cerise.
Finote Espresso Martini (short drink) 8cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de café. Passer au shaker | Grains de café en déco.

Crédit Finote
Finote Sour (ou Shake Me Up) 5cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de jus de pamplemousse |1cl de jus de gingembre | 2cl de jus de citron | 1cl de sirop de sucre de canne | Passer au shaker.
Finote Spritz (long drink) 5cl de Finote Apéritif No1 | 1cl de sirop de sucre de canne |5cl de jus d’orange | 10cl d’eau gazeuse; tranche d’orange et brin de romarin en déco.
Finote Negroni Style 5cl de Finote Apéritif No1 | 5cl de thé noir infusé | 8cl de jus de cranberry.
Finote & Tonic (long drink) 6cl ou 1/3 de Finote Apéritif No1 | 12cl ou 2/3 de tonic.
Le Finote Apéritif No 1 a reçu la Médaille d’Or et le Spritz Orange, gentiane et romarin, la Médaille de bronze lors des World Alcool-Free Awards cette année.
Déjà présent dans des restaurants étoilés Michelin, des hôtels de luxe et des enseignes haut de gamme à travers l'Europe, Finote répond à la demande croissante d'options haut de gamme, sophistiquées et sans alcool.
 Crédit Finote
Crédit Finote
Élodie Swanberg souhaite introduire ses produits Finote dans les marchés québécois et canadien.
Pour la contacter :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
+ 33 (6) 73 12 85 31
www.drinkfinote.com
Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com
Les Crémants d’Alsace, une expérience très festive!
Au mois de mai, j’ai eu le privilège de participer à un événement 100% Crémants d'Alsace organisé par HOPSCOTCH Season (anciennement SOPEXA). À cette occasion 23 vignerons se sont déplacés pour nous offrir ce qu’ils ont de mieux en matière de vins mousseux.
Les Crémants d’Alsace, sont des vins effervescents produits par la méthode traditionnelle depuis la fin du Dix-neuvième siècle. Ils ont été reconnus officiellement comme Appellation d’Origine Contrôlée en 1976. Ils représentent aujourd’hui 36% de la production d’Alsace, c’est-à-dire un peu plus de 43 millions de bouteilles. Sur le marché français, le Crémant d’Alsace est le vin effervescent le plus consommé après le Champagne et dépasse de loin le Crémant de Loire et le Crémant de Bourgogne.
Le Terroir alsacien comprend 13 types de sols différents qui vont du volcanique au calcaire, en passant par l’argile, le schiste et le granit. Cette diversité influe sur les arômes et le goût du vin, ce qui fait que les Crémants d’Alsace offrent une palette d’arômes et de goûts très ample.
L’Alsace est la deuxième région viticole la plus sèche, avec une moyenne de 500 mm de pluie par an. Elle a un climat continental, avec des journées chaudes et des nuits fraîches et beaucoup d’ensoleillement, ce qui produit des vins complexes, aromatiques et équilibrés.
Les cépages autorisés sont : l’Auxerrois, le Chardonnay, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Pinot Noir et le Riesling. Les Crémants d’Alsace blancs représentent 89% de la production et les Crémants d’Alsace rosés 11%.
L’Alsace s’est tournée définitivement vers l’Agriculture biologique avec 35% de sa superficie certifiée bio ou en conversion et 7,2% de sa surface certifiée en biodynamie.
Une constante dans la production des Crémants d’Alsace est la poursuite de la qualité à son plus haut niveau.
Le Domaine Étienne Loew de la commune Westhoffen, nous a présenté son Crémant d’Alsace Rosé NM ‘ALL YOU NEED IS LOEW’, un Extra-brut non dosé avec 36 mois de lattes et 20% de vin de réserve. Pinot Noir, Chardonnay. C’est un grand classique. Alcool 12,8%, acidité 6,47g/L, sucre résiduel seulement 1,2g/L. Superbe!
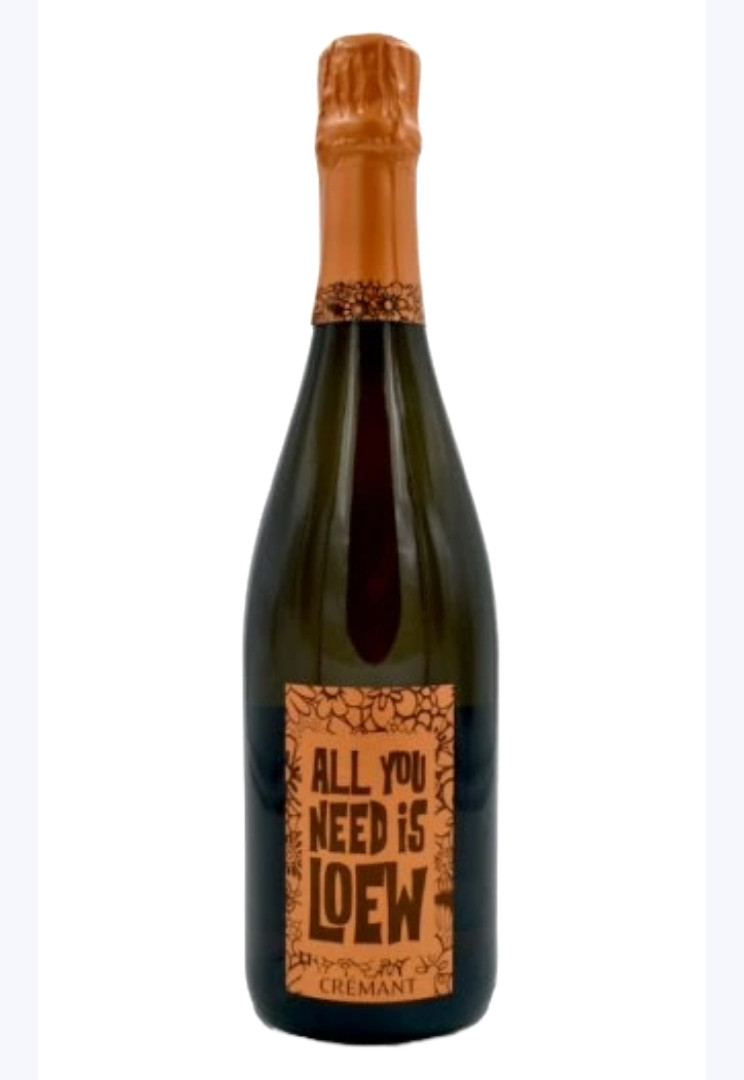
Crédit Dom. Loew
Pour information au vignoble contactez Étienne Loew : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Diane Turcotte, Vini Vins Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel 514 993 3727.
La Maison ZEYSSOLFF, d’Yvan Zeyssolff, commune Gertwiller. Onze générations de la même famille se sont succédées dans l’exploitation de ce vignoble remarquable. Yvan Zeyssolff s’explique : « Nous proposons une gamme de vins authentiques d’Alsace qui mettent en valeur les caractéristiques uniques de chaque cépage que nous cultivons, et nous sommes certifiés bio depuis 2021 ».
Depuis 2002 ils produisent le MAISON ZEYSSOLFF AOC CRÉMANT D’ALSACE NM ‘ASSEMBLAGE’. Pinot Auxerrois, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Gris, 18 mois de maturation sur lies.

Crédit Zeyssolff
Alcool 12%, acidité 7 g/L, sucre résiduel 4,5 g/L. Pour information au vignoble contactez Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Noble Sélection; Mari-Lou Ayotte Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 514 989-9657
Le Domaine Gresser, dirigé par Rémy Gresser, commune Andlau. Il se définit ainsi : « Véritable paysan de la vigne, mon devoir consiste à exprimer dans chaque vin la minéralité, l’énergie et l’identité de son terroir grâce à l’expertise accumulée au fil des générations de la famille. Prendre soin de la nature et de la santé de ceux qui apprécient nos vins, grâce à l’agriculture biologique et à la biodynamie. »
Il nous a présenté deux vins; tout d’abord, le DOMAINE GRESSER AOC CRÉMANT D’ASACE, NM ‘BRUT’. Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, 18 mois de maturation sur lies. 12% d’alcool, 5,96 g/L d’acidité et 4 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Gresser
Ensuite, le DOMAINE GRESSER AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘OPHELIA PAINTING’. Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris et Auxerrois, 60 mois de maturation sur lies; 12,5% d’alcool, 6,84 g/L d’acidité et seulement 2,80 g/L de sucre résiduel. Un vin magnifique. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 06 07 80 13 80. Cherche agent pour le Québec.
Le Domaine Wach est une entreprise familiale qui travaille la vigne depuis 7 générations dans la commune d’Andlau. Pierre Wach dirige l’entreprise avec l’aide de sa compagne Jessica Ouellet qui est une sommelière du Québec. Ils ont des vignes de Chardonnay de plus de 50 ans, et travaillent en bio. Les travaux et les vendanges sont manuels. Ils nous ont présenté deux vins superbes; d’abord le DOMAINE WACH AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘BRUT’. Chardonnay et Pinot noir. Terroir de Schiste. Maturation sur lies jusqu’à 24 mois. Alcool 12,5%, acidité 6 g/L et sucre résiduel 4,5 g/L.

Crédit Domaine Walch
Le deuxième vin est le DOMAINE WACH AOC CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ, NM. Pinot Noir. Profil géologique : Alluvion. Maturation sur lies jusqu’à 24 mois. Alcool 12,5%, acidité 5,92 g/L et sucre résiduel 10 g/L. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Représenté au Québec par TANIUM. Sébastien Clermont Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 514 894-4896
Le Domaine Léon Bleesz de la commune de Reichsfeld est un domaine familial qui possède deux vignobles, un sur un terroir de schiste à Schieferbeg et un autre de grès rose à Sohlenberg. Depuis 2021 ils sont certifiés en agriculture biologique.
Ils nous ont présenté deux vins. Le premier est le DOMAINE LÉON BLEESZ AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM. Pinot Blanc et Riesling. 15 mois de maturation sur lies. Alcool 12,9 % d’alcool, 6,3 g/L et 6,79 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Bleesz
Le deuxième vin est le DOMAINE LÉON BLEESZ AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘BULLES DU HAUT DE REICHFELD’ Chardonnay, Pinot Noir. Sélection parcellaire de la parcelle la plus abrupte du domaine. Pressurage mécanique, débourbage à froid, fermentation lente en cuve thermorégulée. Méthode traditionnelle avec seconde fermentation en bouteille. Maturation sur lies pendant 24 mois. 12,5% d’alcool, acidité 6,5 g/L, sucre résiduel 3,96 g/L. Mathilde Bleesz : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. 07 71 55 22. Ils recherchent un agent pour le Québec.
Le domaine Achillée. En 2016 Pierre et Jean Dietrich construisent à Scherwiller une cave bioclimatique avec des matériaux locaux, respectueux de l’environnement. C’est le plus grand monument de paille autoportant d’Europe et travaillent en agriculture biodynamique certifiée. Ils nous ont présenté deux vins.
Le premier est l’ACHILLÉE AOC CREMANT D’ALSACE 2020 ‘ZÉRO DOSAGE’, Riesling, Pinot Blanc, Auxerrois, Chardonnay et Pinot Noir, cultivés sur des terroirs de graviers de Scherwiller. Élevage en barrique pour les notes oxydées, et in inox pour la fraîcheur et la tension. Chaque cépage est vinifié séparément, et l’assemblage est effectué avant la mise en bouteille, puis 2 ans sur lattes. 24 mois de maturation sur lies; 11% d’alcool, 5,68 g/L d’acidité, 0,8 g/L de sucre résiduel.

Crédit Dom. Achillée
Le deuxième vin est l’ACHILÉE AOC CRÉMANT D’ALSACE NM ‘SOLERA’, Riesling, Pinot Blanc, Auxerrois, Chardonnay et Pinot Noir. Culture sur terrain sableux. Très peu de décantation, aucun ajout de soufre, pas de liqueur d’expédition. Fermentation d’environ 1 mois; élevage en foudres centenaires. Pendant les vendanges ils profitent pour faire une liqueur de tirage. Le vin attend 60 mois sur lattes avant d’être dégorgé toujours sans dosage. Les volumes sont complétés par le même vin. Alcool 10,78 %, acidité 8,2 g/L, sucre résiduel 0,2 g/L, un record.
Ces deux vins sont vraiment magnifiques. Pour information au vignoble : Louise Quintrand Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Ils sont représentés au Québec par Raisonnance, Pierre Birlichi Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel. 514 295-4985.
Le Domaine Allimant-Laugner, dans la commune de Orschviller se trouve au pied du Haut-Koenigsbourg. C’est une propriété familiale depuis 12 générations. Le domaine est spécialisé dans les Crémants d’Alsace qui représentent 60% de la production qui est certifiée biologique. Ils nous ont présenté deux vins : un blanc et un rosé.
L’ALLIMANT-LAUGNER AOC CRÉMANT D’ALSACE NM est fait de Pinot Blanc, Riesling et Pinot Gris, cultivés sur des terroirs granitiques. La fermentation est faite en cuves inox thermorégulées à basse température, sans malolactique. La maturation sur lies dure 18 mois. Le vin titre 12,3% d’alcool, contient une acidité de 6.1 g/L, et 3.5 g/L de sucre résiduel.
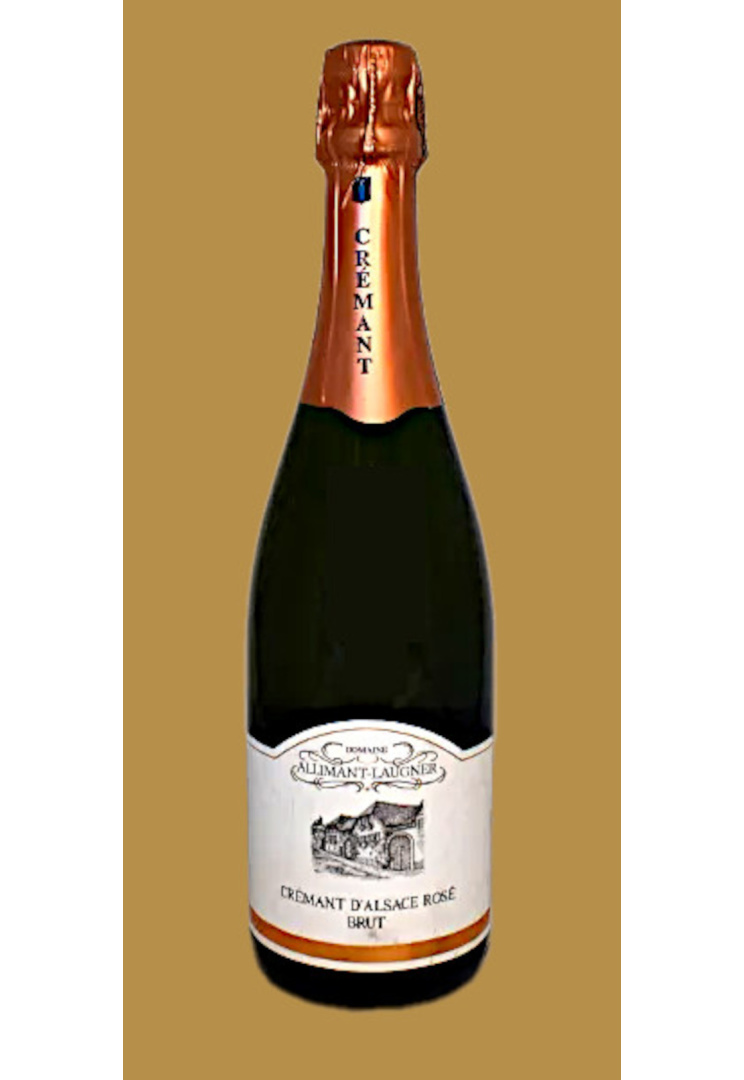
Crédit Allimant-Laugner
L’ALLIMANT-LAUGNER AOC CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ, NM est fait uniquement de Pinot Noir qui provient de parcelles argilo-calcaires. La macération au pressurage dure 6 heures, suivie de flottation, puis de vinification en cuve inox à température contrôlée pendant 30 jours, sans malolactique; 15 mois de maturation sur lies.
Ce rosé titre 12,4% d’alcool, son acidité est de 5,7 g/L et son sucre résiduel de 4,1 g/L.
Ces deux vins sont le fruit d’un grand savoir-faire. Pour information au vignoble contactez Nicolas Laugner Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par l’Agence Roy-co. Caroline Roy Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 438 888-9482.
Le Domaine Fernand Engel, est un important domaine vinicole de la commune de Rorschwihr qui ne vinifie que les raisins qu’il cultive. Leurs vignes poussent sur des terres dont le profil est marno-calcaire à 350 m. d’altitude environ. Elles sont conduites en totalité en Agriculture biologique depuis 23 ans. Cinquante pour cent de la production est exportée.
Ils nous ont présenté deux vins : LE DOMAINE FERNAND ENGEL AOC CRÉMANT D’ALSACE, 2021 ‘BLANC DE NOIRS’. C’est un monocépage qui a 30 mois de maturation sur lies. La fermentation se fait en cuve inox. Ce vin est élevé sur lies en cuve inox pendant 10 mois. Il titre 12% d’alcool, a une acidité de 8,2 g/L et 1,6g/L de sucre résiduel.

Crédit Fernand Engel
Le deuxième vin est le DOMAINE FERNAND ENGEL AOC CRÉMANT D’ALSACE, 2023 ‘BRUT’. C’est un monocépage de Chardonnay. Fermentation en cuves inox à température contrôlée; élevage sur lies en cuve pendant 10 mois. Il titre 12,4% d’alcool, a une acidité de 5,7 g/L et 4 g/L de sucre résiduel. Pour information au domaine contacter Xavier Baril : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par Vins Fins, Sonia Archat : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tel. 514 592-9634
Le Domine Dopff au Moulin, dans la commune de Riquewihr est un domaine familial depuis 1574. C’est Julien Dopff, la 10e génération qui a importé la méthode traditionnelle en Alsace et qui, par conséquence, en est le pionnier. Lors du pressurage lent des baies, seule la cuvée du premier jus est sélectionnée pour l’élaboration des crémants. Après la première fermentation en cuve, intervient l’étape cruciale de l’assemblage. La seconde fermentation s’effectue en bouteilles, selon la méthode traditionnelle. Les cuvées reposent patiemment 24 mois sur lattes pour une plus grande complexité et pour une plus grande finesse de bulles.
Le domaine propose 10 crémants différents à base d’assemblages, ou dosages différents. Le domaine Dopff est en conversion biologique. Il nous a présenté deux vins fantastiques, le premier est le DOPFF AU MOULIN AOC CRÉMANT D’ALSACE, NM ‘CUVÉE JULIEN’, Pinot Blanc et Auxerrois. Ce vin titre 12,5% d’alcool, contient 5,3 g/L d’acidité et 3,9 g/L de sucre résiduel.
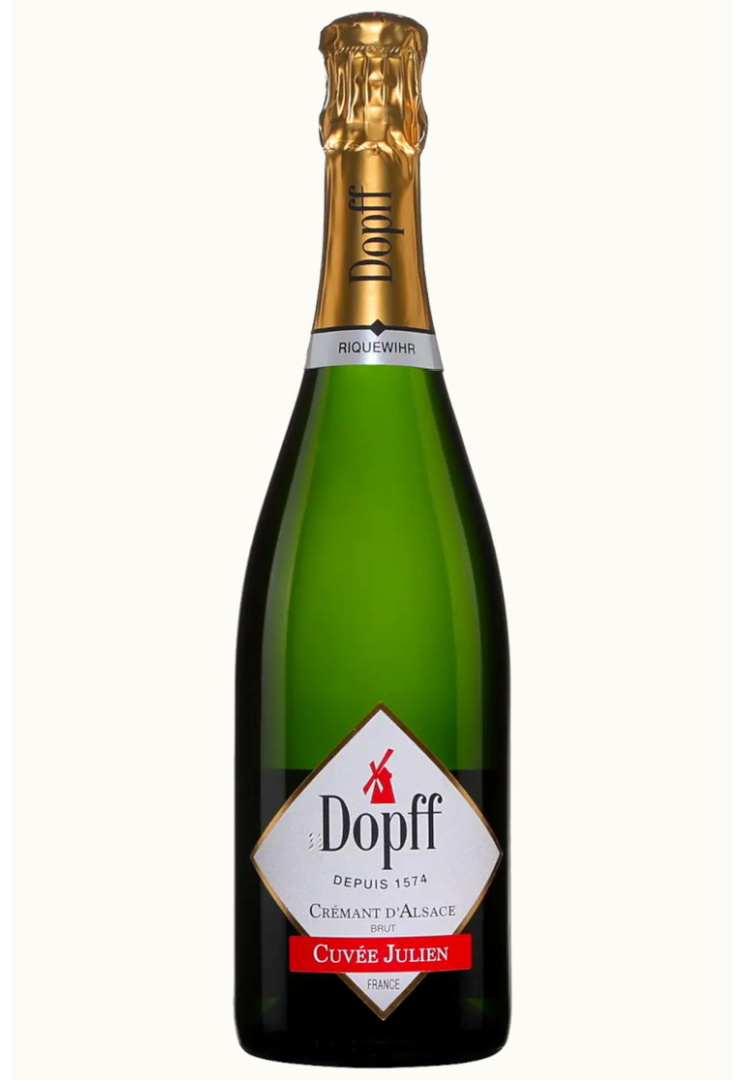
Crédit Dopff
Le deuxième vin est le DOPFF AU MOULIN AOC CRÉMANT D’ALSACE 2020, Chardonnay 100%. 12,5% d’alcool, 6 g/L d’acidité et 3,3 g/L de sucre résiduel. Pour information au vignoble contactez Marlène Dopff Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Ils sont représentés au Québec par l’Agence BMT, Louis Ghiglione Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Je n’ai pas eu l’occasion de converser ni de goûter aux Crémants d’Alsace des autres vignerons car ils étaient nombreux, mais je suis sûr que tous étaient excellents. Les Crémants d’Alsace sont des vins effervescents produits dans les règles de l’art par des gens passionnées et qui nous parviennent à des prix plus qu’abordables! Ce sont des vins de célébration et des vins de gourmandise qui ont toutes les qualités pour transformer un repas en banquet quand on est en bonne compagnie!
Roger Huet, chroniqueur
LaMetropole.com – gastronomie/vins
SamyRabbat.com
Vins de rêve de la Géorgie
Nous avons eu l’agréable visite d’Aleksandre Margvelashvili vigneron en Géorgie (Europe de l’Est), directeur du domaine TBILVINO, qui nous a fait découvrir des vins avec beaucoup de personnalité, de cépages inconnus pour nous en Amérique du Nord.
La Géorgie est une des régions où l’on faisait du vin depuis 8000 ans. Traditionnellement et jusqu’à aujourd’hui les vins sont produits dans des grands récipients en terre cuite, souvent émaillés, beaucoup plus larges au milieu qu'au fond et à l'embouchure, et encastrés dans le sol. Chacun peut contenir de 300 à 1000 litres. C’est une vinification ne nécessite d’aucune intervention. La porosité de la terre cuite permet une oxygénation lente qui ne modifie ni les arômes ni le gout mais qui arrondit les tannins.
TBILVINO est un domaine vinicole de 400 Hectares qui a été racheté par la famille Margvelashvili en 1996. Le père d’Aleksandre a acquis une formation viti-vinicole en Californie où il a travaillé pendant plusieurs années avant de s’installer en Géorgie. Leur maître de chai est Iviad Lodadze, une éminence dans la région. Ils ont dû pratiquement reconstruire le vignoble qui avait été abandonné dans le temps où la Géorgie avait été forcée à intégrer l’URSS.
À TBILVINO ils produisent des vins blancs, rouges et rosés et développent maintenant des vins orange de gastronomie. Leur production annuelle est de 4 millions de bouteilles dont la moitié est consommée en Russie.
J’ai dégusté tout d’abord un vin blanc : MTSVANE SINGLE VINEYARD 2023.

Le raisin provient du vignoble de Shashiani, dont les sols sont argileux et propices à la culture des cépages blancs.
La fermentation se fait en cuves inox à température contrôlée, suivie d’un vieillissement de 8 mois, dont 10% en fûts de chêne. Le vin titre 11% d’alcool, son acidité est de 7 gr/l et le sucre résiduel de 4gr/l.
Très belle robe dorée-pâle avec des reflets verts. Un parfum de fleurs et de fruits tropicaux avec des notes épicées. En bouche il est léger, gourmand, avec beaucoup de fraicheur, et offre une fin de bouche qui se prolonge agréablement. C’est un excellent compagnon pour les fruits de mer, les poissons à chair blanche, la volaille et les fromages de chèvre.
Nous avons ensuite dégusté le vin orange QUEVRIS KISI 2022, 100% cépage Kisi blanc, totalement inconnu en Amérique du Nord.

Le vignoble se trouve dans la région de Sashiani à 400 m d’altitude. Les sols sont argileux à texture caillouteuse et à fertilité modérée, contribuant à une croissance équilibrée de la vigne.
La fermentation et macération se fait avec les peaux du raisin, pendant 4 mois, à température contrôlée en cuves inox. Le vin titre 12,5% d’alcool, il a une acidité de 4.50 g/l et 3 g/l de sucre résiduel.
Sa robe orange est brillante et dévoile un vin corsé, riche en arômes de fruits jaunes secs, principalement d’abricot, de pêche et de coing. En bouche c’est un vin qui a du chien, c’est-à-dire une forte et belle personnalité ; des tanins mûrs et veloutés et une structure bien équilibrée. Il est surprenant et charmeur jusqu’à la dernière goute.
C’est un vin idéal pour des mets aigre-doux, dans le style de la cuisine Thaï ou le ceviche péruvien. Bon également avec des desserts.
Nous avons dégusté ensuite 4 vins rouges.
Le premier rouge était le SAPERAVI SINGLE VINEYARD 2021, 100% Saperavi, un autre cépage inconnu en Amérique du nord.

Il provient de la région de Vachnadziani, de parcelles choisies sur des sols alluviaux fertiles situés à 450 m d’altitude. On y fait une récolte en vert au printemps pour augmenter la concentration du fruit au moment de la récolte pour le vin.
Le vin est vieilli pendant 15 mois dans des fûts en de chêne. Il titre 14% d’alcool, a une acidité de 5 g/l et un taux de sucre résiduel de 4 g/l.
La robe est rubis foncé, aux reflets brique. Bouquet de fruits rouges, de cerise mûre, des notes de cannelle et de vanille, un soupçon de minéralité et de fumé. En bouche c’est un vin ample, avec beaucoup de personnalité, des tanins élégants et veloutés un bel équilibre entre l’acidité, la masse fruitée et les tanins. Une finale longue et très agréable jusqu’en fin de bouche.
C’est un vin idéal pour les grillades et les fromages forts.
Le deuxième rouge dégusté était le QUEVRIS SAPERAVI 2022, un monocépage 100% Saperavi.

Le raisin provient de deux régions : Vachnadziani et Kakheti, qui ont des étés chauds et secs et offrent des conditions optimales pour la maturation du raisin. Après la fermentation, 40% du vin vieillit en fûts de chêne et 60% en récipients en terre-cuite encastrées dans le sol. Le vin titre 15% d’alcool, a une acidité de 4,50 g/l. et 5 g/l de sucre résiduel.
Robe rouge soutenue. Bouquet de mûre prédominant et un peu de poivre noire. En bouche c’est un vin généreux, très tannique mais à la fois délicieusement gourmand, frais. La finale est longue et agréable jusqu’à la dernière goute.
Parfait avec les viandes : bœuf, agneau, porc. Il aime les mets mijotés avec des sauces aux champignons et les fromages à croûte dure comme le Comté du Jura. Il pourra se conserver facilement 10 ans en cave.
Le Troisième vin rouge était le SAPERAVI TWIN VINEYARDS 2022, 100% Saperavi qui provient de trois régions : Kakheti, Sashiani et Vachnadziani. Il devrait s’appeler Triplet plutôt que Twin, mais le nom lui a été imposé lorsqu’il provenait de deux régions à l’origine.

Le fait de provenir de régions qui ont des sols alluviaux, et d’autres qui sont argilo-calcaires, apporte une plus grande richesse au vin.
Le vin vieillit en amphore à 60%, mais en fûts de chêne pour 40%. Il titre 15% d’alcool, 4,50 g/l d’acidité et contient 4 g/l de sucre résiduel. Sa robe est rouge-foncé, presque noire, au point qu’on peut presque voir son reflet dans le verre. Un bouquet intense et complexe de fruits noirs : mûre, myrtille, prune noire, cerise noire, avec de subtiles notes épicées et vanillées qui confèrent au vin un parfum confituré intense. La bouche est magnifique, ample, gourmande, savoureuse, avec des tanins royaux, élégants, une belle acidité et une note d’amertume merveilleusement persistante, qui se prolonge jusqu'à une finale. C’est un vin de gastronomie qui se marie merveilleusement avec les viandes préparées de toutes les façons, qui aime les champignons riches, comme la truffe, le porcini, les bolets, et qui sublime tous les mets qui contiennent du fromage. Merveilleux naturellement avec le Camembert bien fait et les bleus. Ce vin va se conserver en cave au-delà de 10 ans.
Le quatrième vin rouge était le PLOT # 3, millésime 2020, Saperavi 100%.

La vigne est cultivée dans leur terroir de 128 hectares à Vachnadziani, crée en 2013. Les sols sont une composition de terres alluviales et de roche concassée. Une vendange en vert à la moitié de la production permet d’obtenir par la suite une concentration remarquable, qui a surpris même leur équipe d’œnologues. Le vin qui macère pour environ 22 jours en cuves inox, vieillit ensuite en fûts de chêne pendant 2 ans. C’est un vin haut de gamme, qui titre 15% d’alcool, il a 4,5 g/l d’acidité et 4 g/l de sucre résiduel.
Robe magnifique d’un rouge très foncé. Bouquet généreux de fruits rouges : bluet, myrtille, mûre, cerise noire, des notes poivrées et vanillées. En bouche c’est un vin généreux, glorieux, tannique mais en même temps velouté, acide, mais dans sa fraîcheur il y a beaucoup de rondeur et une finale, longue, longue, qui appelle un autre verre. C’est un vin de gourmandise qu’il faut servir à 17 degrés.
Le PLOT # 3 est un vin de gastronomie qui appelle les viandes en grillade, mais aussi mijotées, qui va faire d’un lièvre un festin, d’un agneau un banquet, d’un bœuf un moment inoubliable. Apportez les fromages, de toutes sortes, les champignons même dans les variétés exotiques et le Plot # 3 va tous les sublimer. C’est un vin de très longue garde qui peut dépasser facilement les 20 ans!
Aleksandre Margvelashvili recherche agents pour le Québec et l’Ontario. Si vous avez déjà une carte de vins sur un vaste éventail, pour satisfaire tous les goûts, alors il vous faut les vins extraordinaires de TBILVINO de la Géorgie, qui, les seuls, pourront encore surprendre et ravir une coche plus haut vos clients, car ils atteignent l’extraordinaire.
Pour information contacter :
Lisa Ulrich
Senior Project Manager
Andros Communications
Tel: 905-637-2100
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Roger Huet
SamyRabbat.com
Mornico Losana: renaissance d’un village lombard au cœur d’une téléréalité
Un tournant stratégique
Perdu dans les collines de L’Oltrepò Pavese, entre la vallée du Verzate et la plaine du Pô, se dresse le village médiéval de Mornico Losana, près de 600 habitants. En juin 2025, ce petit bourg de Lombardie a vu sa destinée bouleversée grâce au tournage à l’année de la nouvelle saison de Chateau Meiland, émission néerlandaise à grand succès. Les producteurs ont choisi ce lieu plutôt que Sanremo ou Bellagio, attirés par son charme authentique et ses paysages.
Une maire visionnaire
Au cœur de cette success-story, la maire Ilaria Rosati, une ancienne enseignante au regard tourné vers l’international. Elle a su attirer des investisseurs, notamment un couple néerlandais qui a lancé un glamping éco-responsable, prélude à des initiatives durables. Ce projet a déclenché l’intérêt des médias et des fondations politiques régionales, comme rappelé par Barbara Mazzali, conseillère au Tourisme de la Lombardie.
Lombardie, la région de rêve du Nord de l’Italie, à visiter absolument
La Lombardie offre aux voyageurs canadiens la possibilité de découvertes qui surpassent toutes les autres régions d’Italie.

Mme Barbara Mazzali, Crédit photo @Roger Huet
Barbara Mazzali, Conseillère régionale pour le tourisme, le marketing territorial et la mode nous a rendu visite pour nous faire découvrir une Lombardie authentique, élégante, et innovante, avec une grande diversité géographique et culturelle, qui va ravir les voyageurs canadiens et québécois. Avec la précieuse collaboration de la Chambre de commerce italienne au Canada. Mme. Mazzali a établi un partenariat avec Air Canada et Vacances Air Canada, qui propose dorénavant une liaison Milan-Malpensa/Montréal, accessible toute l’année avec des vols directs et des forfaits de voyages.
Les voyagistes et agences de voyages peuvent présenter dès maintenant, une offre touristique qui n’est pas seulement une destination, mais une expérience extrêmement enrichissante. La Lombardie est unique au monde pour son patrimoine historique et artistique, pour ses villages et ses lacs fabuleux, ses sentiers de randonnée et ses sommets imposants. Sa gastronomie et ses vins incroyables.

Mme Barbara Mazzali entre le consul général d’Italie à Montréal M. Enrico Pavone, à gauche et le directeur général de la Chambre Italienne de Commerce au Canada, M. Francesco Biondi Morra di Belforte. Photographie d’événements, crédit photo @Mélissa Vincelli.
La Lombardie est aussi le « Cœur de l’Italie du Nord ». Elle a une superficie de 23 857 km2 et une population de 10 millions d’habitants. C’est l’une des plus grandes régions d’Italie. Elle se découpe en douze provinces qui prennent généralement leur nom de celui de leurs capitales. Elles résonnent comme des incantations magiques: Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Lecco, Lodi, Mantoue, Milan, Monza et Brianza, Pavie, Sondrio et Varèse.
Les rosés pétillants de Camargue chantent le printemps dans les verres
Le plus accompli des rosés de Provence est le PIVE ROSÉ BRUT AOP Sable de Camargue, de la Maison JeanJean. Il est fait de 25% Grenache gris, 25% Grenache noir, 25% Cinsault, 15% Merlot et 10% Syrah; il ne titre que 12 degrés d’alcool.
Les terroirs sont composés de sables fins d’origine marine et éolienne du littoral de Camargue.
La vinification se fait en deux étapes : dans la première on obtient le vin de base. On fait des vendanges nocturnes pour conserver au fruit sa fraîcheur et éviter un début de fermentation. On procède rapidement à la récupération du jus de goutte et du jus de presse, et on les soumet au refroidissement et débourbage statique en cuve. Au terme du débourbage, 90% du vin est vinifié de manière traditionnelle et 10% est mis à l’écart et congelé à -20 degrés Celsius. Dans la deuxième étape, un mois plus tard, on relance une 2ème fermentation en cuve close: les 10% décongelés sont ajoutés au vin de base et on procède à l’ajout de levures de "prise de mousse". Le choix de rajouter du jus décongelé issu du même vin de base permet de renforcer le côté fruité et éclatant du vin.
Après 1 mois de fermentation en cuve close, le vin est mis en bouteille sous pression et dosage (liqueur d'expédition, 4 g/l). L’élevage qui s’en suit dure 2 mois. Le vin a une pression en bouteille de 5,5 bars. C’est un vin certifié Bio.

La robe de ce vin est d’un magnifique rose pâle, avec un léger reflet saumoné; des fines bulles légères et persistantes qui ne demandent qu’à nous caresser la bouche.
Au nez, on perçoit des arômes fleuris mais aussi fruités de cerise noire, de fraise, de cassis, de mûre, avec des touches de figue sèche, un soupçon de réglisse.
En bouche c’est un vin ample, avec une puissante trame de fond à cause de l’abondance de notes de fleurs et de fruits où prédomine la fraise. Il est généreux et équilibré et montre une charmante onctuosité et une finale d’une belle longueur.
Le Pive Rosé Brut est le vin idéal à savourer sur la terrasse en fin de matinée ou en soirée avec des mise-en-bouche. Il se marie aussi très bien avec un plat d’asperges blanches mayonnaise, des salades de fruits de mer, des poissons gras comme le saumon et la truite. On a du plaisir à le retrouver au dessert avec des tartelettes aux fraises ou avec des sorbets.
On recommande de le servir entre 8 et 10 degrés Celsius. Moi je préfère de le servir à 6 degrés et de le boire tout doucement en le savourant. Il aura ainsi le temps de se réchauffer dans le verre, de dégager tous ses arômes et de vous donner bien plus de plaisir. Ce vin a un potentiel de garde de 10 ans.
Le Pive Rosé Brut des Vignobles Jeanjean est disponible à la SAQ, code 14493310. Prix 25 $.
LE PIVE BLANC 2024 - IGP PAYS D'OC, Ecocert Bio de la Maison JeanJean exprime la passion de la Camargue. Il est 40% Sauvignon blanc, 30% Rolle (Vermentino), 30% Viognier. Il titre 12 degrés d’alcool et son sucre résiduel est seulement de 1,6gr/l, ce qui fait de lui un vin sec.
La vigne pousse sur des terrains sableux avec des coquillages. Le climat de la Camargue est méditerranéen chaud et sec, mais tempéré par la proximité de la mer.
Le Sauvignon, le Rolle (Vermentino) et le Viognier se complémentent et s’équilibrent parfaitement dans cet assemblage. Le Sauvignon est vendangé à la mi-août, le Viognier et le Rolle vers la mi-septembre. Les vendanges sont nocturnes pour profiter de la fraîcheur et éviter que le raisin commence à fermenter avant son arrivée au chai. Presse pneumatique. Fermentation uniquement alcoolique pour conserver toute la fraîcheur du jus.

La robe est jaune pâle, brillante avec des reflets verts.
Le nez perçoit des parfums intenses d’abricot, de fleurs blanches et d'agrumes.
En bouche le Pive Blanc est un vin vif et aromatique ou les agrumes se mélangent avec des notes de fleurs. Son acidité apporte une belle fraîcheur qui se poursuit jusqu’en finale, avec des notes fruitées. Ce vin de plaisir est dans la lignée du Pive Gris. À déguster en toutes circonstances.
Très bon à savourer en apéritif ou sur le comptoir d’un bar. Merveilleux en accompagnement de fruits de mer, de salades, de fromages de chèvre et des tartes aux fruits.
Je suggère toujours de le servir assez frais et de le savourer doucement. Il sera à son meilleur lorsqu’il parviendra entre 10 et 12 degrés, mais quel plaisir de le sentir évoluer gorgée après gorgée. Il a un potentiel de garde de 2 ans.
Le Pive blanc Pays d’Oc est disponible à la SAQ, code 13806097. Prix 17,35 $.
Le Pive Gris, un vin rosé AOP Sable de Camargue en canette de 250 ml c’est le vin des voyageurs.

À pied, à cheval, en voiture, sur un yacht ou sur un chameau au milieu du Sahara, c’est le vin idéal, le vin de l’aventure. Dans le cœur de la forêt Amazonienne ou au sommet de l’Aconcagua pour célébrer sa victoire, on peut faire tchin, tchin, parce qu’il est facile à transporter, sécuritaire et léger.
Il est fait de : Grenache gris 30%, Grenache noir 30%, Merlot 30% et Syrah 10% cultivés sur les terres sablonneuses de la Camargue éternelle. Il est Bio et ne contient que 12 degrés d’alcool ; il est très sec, avec une teneur en sucre résiduel de seulement 1,2 gr/l.
Comme vous allez le boire à la canette je vous dirai seulement que sa robe est légèrement rosée. Par contre vous apprécierez son parfum fleuri et fruité. En bouche il est léger, acide, donc plein de fraîcheur, délicieusement caressant en bouche. C’est un vin convivial qui accompagnera magnifiquement tout ce que vous pouvez transporter dans votre corbeille de pique-nique ou dans votre sac à dos. Il est inutile également de vous recommander une température. La température idéale pour vous sera celle où vous vous trouverez. Dans les tropiques il vous apportera la fraîcheur de son acidité et en haute montagne où vous aurez beaucoup transpiré pour arriver si haut vous le trouverez rafraîchissant de toutes façons. Tchin, tchin !
Le Pive Gris, un vin rosé AOP Sable de Camargue en canette de 250 ml est disponible à la SAQ, code 14736297. Prix 6,40 $
Références :
Producteur : Vignobles JeanJean
Agent promotionnel : Sélect Vins Advini inc.
Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
SamyRabbat.com
LaMetropole.com
L’incomparable Maison Edme Champy en Bourgogne
La Bourgogne est chargée d’histoire. Les premiers vignobles apparaissent sur les rives du Rhin au premier siècle de notre ère. Les légions romaines, après la conquête de la Gaule, y ont introduit les premiers cépages dans le but de faire du vin pour l’usage des légionnaires et éviter les longs et coûteux voyages des tonneaux et des amphores depuis l’Italie.
Pendant le Moyen-Âge, les nobles et les moines ont créé des vignobles dans leurs domaines, à côté de leurs châteaux et de leurs couvents. Aujourd’hui encore, certains persévèrent et leurs noms sont très prestigieux, ainsi le château de Santenay, aussi connu comme le Château de Philippe le Hardi. C’était un château de terre et de bois au quatrième siècle, qui a été remplacé au douzième siècle par un donjon en pierre. Il a été donné, à la fin du quatorzième siècle, à Philippe le Hardy, fils du Roi de France, lorsqu’on a constitué pour lui le Duché de Bourgogne. Les vins de ce château sont devenus célèbres.
Le Château du Clos de Vougeot, fondé en 1115 par les moines de Cîteaux, est aussi célèbre pour ses grands vins et ses vignes centenaires. La confrérie des Chevaliers du Tastevin y a élu son domicile.
Il y a aussi le Clos de Tart, fondé au 12e siècle; il produit des grands crus en Côte de Nuits.
N’oublions pas le Château de Pommard fondé en 1726, qui est un des plus anciens domaines viticoles de la région. Son Clos Marey-Monge réunit sept parcelles distinctes au sein de l’un des Climats du vignoble de Bourgogne reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Maison Champy est la plus ancienne maison de négoce de vins de Bourgogne, implantée à Beaune. Elle a été fondée en 1720 par Edme Champy, tonnelier. À la Révolution française (1789-1799), l’État, qui avait un grand besoin d’argent pour faire face à ses guerres avec ses voisins, expropria les terres des nobles et des monastères pour les vendre aux encans. La Maison Champy devint alors producteur, en plus de négociant éleveur.
 Crédit photo: Maison Champy
Crédit photo: Maison Champy
Vers la fin du dix-huitième siècle, Nicolas Appert met au point un procédé thermique dans un contenant étanche, pour la conservation des aliments. En 1846, Alfred de Lamotte démontre par des essais que le chauffage peut conserver un vin qui, non chauffé, se corrompt.
L’empereur Napoléon III demande à Louis Pasteur, en 1863, de vérifier cette méthode pour le vin qui doit desservir l’énorme marché anglais, car certains vins avaient tendance à se transformer en vinaigre. Pasteur travaille avec Claude Champy sur la pasteurisation des vins du domaine et dépose, le 11 avril 1865, un brevet pour un procédé de conservation du vin par chauffage. La pasteurisation du vin a été abandonnée définitivement à la fin du dix-neuvième siècle, lorsque a crise du phylloxéra a ravagé le vignoble français.
La maison Champy a été cédée à une autre importante maison de négoce, la Maison Jadot, qui sera finalement cédée à Henri et Pierre Meurgey, de la Société Divas.
En décembre 2013, Dimitri Bazas, œnologue du domaine depuis 1999, devient directeur technique de la Maison Champy.

Crédit photo: Maison Champy
Le domaine comporte une activité de récoltant et de vinificateur sur les 29 hectares en production et une activité de négociant-éleveur. Cette dernière permet à la Maison Champy de commercialiser d’autres appellations bourguignonnes qu’elle ne possède pas dans son patrimoine. C’est notamment le cas pour des appellations de la Côte de Nuits (Vosne-Romanée, Chambertin…) et de la Côte de Beaune (Puligny-Montrachet, Meursault…) achetées en raisins, mais également pour des appellations du vignoble du Mâconnais (Mâcon Village…) achetées en moûts.
 Crédit photo: Maison Champy
Crédit photo: Maison Champy
En octobre 2016, la Maison Champy est rachetée par le groupe français Advini.
 Crédit photo: Maison Champy
Crédit photo: Maison Champy
Son siège social, à Côte de Beaune, exhibe une architecture inspirée de l’école Eiffel. Elle est listée aux Monuments historiques, tout comme ses caves d’élevage de La Cloche qui datent du quinzième siècle.
La Maison Champy a été homologuée Entreprise patrimoine mondial par l’UNESCO.
Les vinifications sont menées de manière classique pour la Bourgogne, remontages, pigeages, macération préfermentaire à froid, et levures naturelles.
La cuvée emblématique du Bourgogne Chardonnay de la Maison Champy porte le prénom de son fondateur : Edme. Elle provient d’un assemblage d’une sélection de pièces de Chardonnay issues des terroirs de Puligny, de Meursault et de Rully, en plus des raisins issus du domaine, provenant d'une parcelle au nord de Mâcon. Vinification traditionnelle, levures naturelles. Élevage de 10 mois en fûts, dont 30% de fûts neufs.

Crédit photo: Maison Champy
J’ai goûté à la divine Cuvée Edme 2022, Grand Vin de Bourgogne, AOC BOURGOGNE. Elle titre 13% d'alcool et a un taux de sucre de 2,1 g/L.
Sa robe est or pâle avec des reflets verts, brillante et belle. Parfum de bonne intensité aromatique, élégant et surtout d’une incroyable diversité qui s’ouvre sur des notes florales : tilleul, chèvrefeuille, fleur d’oranger et acacia. On découvre ensuite des notes fruitées : la poire, la pêche blanche, le litchi, et on arrive comme par miracle à des notes de fruits secs : amande, amande grillée, noix, puis beurre et biscuit.
En bouche, c’est la même élégance perçue au nez qui prévaut. C’est un vin ample, sec, avec beaucoup de gras, une belle fraîcheur, très équilibré, puissant, aromatique, caressant jusqu’en fin de bouche, qui est longue et persistante. Cette Cuvée Edme doit surtout être dégustée très lentement, en la méditant. Certains vous diront qu’il faut la servir à 10 ou même à 12 degrés. Je vous dirai : servez-la à 7 degrés et surtout, ne vous pressez pas à boire. Le vin se réchauffera dans votre verre, entre vos lèvres et votre bouche, et il parviendra alors à 10, 11 et 12 degrés en vous livrant tous ses trésors.

Crédit photo: Maison Champy
Jean-Baptiste Mouton, directeur général de la maison et gourmet renommé, suggère de servir ce vin en accompagnement de tartares de poisson aux herbes fraîches, de crustacés grillés, de matelote de poisson, de coquilles Saint-Jacques juste saisies ou d’un fromage de chèvre (Cabécou, Rocamadour, Aisy cendré…). Il a raison, cela fait des mariages heureux.
Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme 2022 est disponible à la SAQ, code 11293742, prix 30,75$.
Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
SamyRabbat.com
Stellenbosch est un des plus anciens vignobles du Nouveau Monde
Voici comment Louis XIV a contribué à faire pousser la vigne et produire du vin en Afrique du Sud : une sordide affaire de magie noire et d’empoisonnements secoue la cour de Louis XIV, le Roi-Soleil dès 1672. Quatre cents personnes sont accusées et condamnées. Une partie de l’aristocratie française était impliquée dans des affaires de magie noire. Une des condamnées au bûcher accusa la maîtresse officielle du roi, Mme De Montespan, de s’être livrée chez-elle à des messes noires dans le but de conserver son pouvoir sur le souverain, et d’avoir acheté des poisons pour éliminer des rivales. Mme De Montespan fut bannie de Versailles et en 1691 elle choisit de se retirer dans le couvent de nonnes de Saint-Joseph à Paris pour expier ses fautes. Le roi fut déstabilisé et écœuré par cette affaire qui le touchait profondément et qui salissait sa cour.
Madame de Maintenon avait été admise au service de madame de Montespan en 1669, comme gouvernante des sept enfants que le roi avait eus avec elle. Quand le roi les légitima dès 1673, Madame de Maintenon fut admise officiellement à la cour où elle rencontrait souvent le roi en tant que gouvernante de ses enfants. Elle profita du renvoi de sa patronne pour devenir la confidente du roi, avec l’aide du Parti Dévot qui était puissant. Elle invitait le roi à méditer sur la façon de sauver son âme de la damnation éternelle, à se repentir de sa vie débauchée, et réussit à le dominer en le terrorisant. En octobre 1683, quelques mois après le décès de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, le roi veuf épousa en secret Mme de Maintenon. Louis XIV avait alors 45 ans. Il était malade et vieilli prématurément, mais vivra encore 32 ans et aura le temps de commettre bien des fautes politiques. Versailles, qui était réputé pour ses fêtes, devint un palais terne que les nobles délaissaient. Le Parti des Dévots eut alors le champ libre. Leur objectif avoué, c’était la destruction des huguenots et l’éradication du protestantisme de France. Ils ne réussirent que très bien.
Henri IV, le grand-père de Louis XIV, avait signé l’Édit de Nantes le 30 avril 1598 et avait mis fin aux guerres de religion qui avaient ruiné la France entre 1560 et 1610. Cet édit concédait aux protestants le droit de pratiquer leur religion à certaines conditions et leur accordait 100 places fortes en France. Sous la coupe de Mme De Maintenon, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes le 18 octobre 1685. Le culte protestant fût interdit, les temples détruits, plus de 200 000 protestants furent contraints à l’exil aux Pays-Bas, en Angleterre, en Prusse et en Amérique. Les conséquences pour la France ont été désastreuses, car la religion protestante exhortait les fidèles au travail, à l’étude et à l’abstinence. De grandes fortunes quittèrent la France, ainsi que des intellectuels, des professeurs, des techniciens de grande valeur et des fermiers expérimentés. La France connut une grave crise financière.
Les Pays-Bas furent les grands bénéficiaires de cette immigration huguenote française. Ce sont eux qui ont développé la culture des tulipes et amélioré l’élevage laitier qui y est parvenu à cette grande qualité qu’on lui connaît. Par contre, les vignerons français se trouvèrent en difficulté car les terres du Pays-Bas n’étaient pas favorables à la culture de la vigne. Depuis des siècles, les marchands de ce pays, comme ceux d’Angleterre importaient leurs vins de la région de Bordeaux et leur cognac de la Charente et des quelques communes de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Louis XIV leur interdit d’exporter aux Pays-Bas et en Angleterre. Les Anglais se tournèrent alors vers la région de Porto, au Portugal, et développèrent le commerce du porto. Les Hollandais firent la même chose et encore aujourd’hui, il y a plusieurs grands producteurs de Porto qui portent des noms hollandais. Ils convainquirent aussi 200 familles vigneronnes françaises, de religion protestante, de s’installer en Afrique du Sud à côté des Boers, les paysans hollandais. Chaque famille reçut de 15 à 30 hectares — ainsi que les outils et les ceps nécessaires. Les huguenots se sont fixés à une soixantaine de kilomètres au nord-est du Cap, entre Paarl et ce qui devait devenir le Franschhoek, le «coin des Français».
Aujourd’hui, le Franschhoek est un petit village charmant situé à 80 kilomètres à l’est du Cap, au cœur de la région des vins. Il fait partie du Triangle d’Or des vignobles avec Stellenbosch et Paarl. Malgré ses airs hollandais avec son architecture Cape Dutch, typique de la région, l’endroit rappellera à tout français le bon souvenir du pays. Franschhoek ne signifie pas «le coin des Français» en afrikaans pour rien! On peut, par exemple, déguster du vin au domaine de «Grande Provence», dîner à «La Petite Colombe», l’un des meilleurs restaurants du pays, et loger à «La Petite Ferme». Le seul hic est que personne ne parle français, car il y a eu une empoignade très vicieuse entre Afrikaners et Anglais pour imposer leur langue aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, dont les Français ont fait les frais.
Advini, le puissant groupe viti-vinicole français, possède 5 propriétés de prestige en Afrique du Sud : L’Avenir, Le Bonheur, Ken Forrester Vineyards, Kleine Zalze et Stellenbosch Vineyards.
Je vais vous présenter l’Avenir et son plus récent vin, qui est le Pinot Grigio 2024, une pépite d’or.
Le domaine de l’Avenir est situé sur les flancs du mont Simonsberg, à Stellenbosch. Il se trouve au cœur de l’appellation la plus prisée d’Afrique du Sud. Le sol de ce terroir est de schiste et de Glenrosa. C’est un domaine viticole de premier plan qui est spécialisé dans les vins issus des cépages emblématiques d’Afrique du Sud que sont le Pinotage et le Chenin blanc et qui produit depuis très récemment un charmant Pinot gris.
L’histoire de ce domaine remonte à la fin des années 1600, lorsqu’il a été un des tout premiers sites identifiés pour la culture de la vigne par des colons français protestants réfugiés, qui se sont installés à Stellenbosch pour faire du vin.
Le domaine a été rebaptisé L’Avenir en 1992 par Mark Wiehe, un homme d’affaires mauricien, qui a abandonné sa carrière de négociant en sucre à Londres pour racheter cette ferme.
Wiehe a nommé François Naudé, reconnu pour ses vins ciselés, vigneron de L’Avenir, et le domaine a rapidement acquis une reconnaissance pour son Pinotage et son Chenin blanc qui se sont avérés remarquables. En 2005, L’Avenir a été racheté par Michel Laroche, le propriétaire de la prestigieuse propriété chablisienne Laroche en France.
En 2007, sous le mentorat de Naudé, l'actuel vigneron Dirk Coetzee a rejoint la ferme après avoir obtenu son diplôme en viticulture et œnologie à l'Université de Stellenbosch. Ce jeune et talentueux œnologue a joué un rôle déterminant dans la mise en valeur des vignobles exceptionnels de L’Avenir, en créant la célèbre gamme L’Avenir Single Block.

Portrait de Dirk Coetzee. Crédit photo : Advini
En 2010, la famille Jeanjean a créé AdVini et a acquis les vignobles de Michel Laroche, dont L’Avenir à Stellenbosch. Cela a marqué le début d’une nouvelle ère pour L’Avenir, qui a intégré un des groupes vinicoles parmi les plus acclamés et primés au monde.
L'approche œnologique de L'Avenir se concentre sur une intervention minimisée, une gestion méticuleuse des vignobles et une récolte manuelle au travers d’une équipe multigénérationnelle de travailleurs agricoles. Dans la cave, ils recherchent à exprimer l’intensité et la pureté du fruit qu’ils obtiennent dans la vigne.
L’Avenir produit des vins sud-africains authentiques, avec une touche française. Les vins de L’Avenir ont une clientèle de passionnés et sont exportés dans plus de 30 pays.

L’Avenir : Pinot Griggio. Crédit photo : Advini
J’ai dégusté le Pinot Grigio du Vignoble L’Avenir millésime 2024, un vin blanc qui exprime parfaitement le terroir de la région de Stellenbosch. Cépage 100 % Pinot gris, 12,5 % d’alcool, taux de sucre résiduel seulement 2,9 g/L, acidité de 5,7g/L.
Les vignobles sont situés sur des pentes exposées à l’ouest dans la région de Devon Valley à Stellenbosch. Elles bénéficient du soleil de l’après-midi et des brises rafraichissantes de l’océan Atlantique. Les vignes sont cultivées en palissage à 5 fils. Les raisins sont vendangés à maturité et macérés avec les peaux pendant deux jours avant la fermentation, qui est faite exclusivement en cuves d’acier à une température contrôlée de 13 à 15 degrés Celsius.
Robe or-pâle, cristalline. Parfum de melon, poire, pêche et fleur d’oranger. Une note miellée et des effluves gourmandes de fruits secs, d’abricot et de cire d’abeille.
En bouche c’est un vin pur, léger, croustillant et vibrant à la fois. Il est d’une grande finesse, soutenue par une jolie tension. En finale il est long et savoureux.
Ce Pinot Grigio est parfait en apéritif, mais il se marie aussi très bien avec des poissons, des sushis, des viandes blanches, des pâtes crémeuses et des fruits de mer. Pour qu’il livre toute sa complexité aromatique, je suggère de le mettre en carafe une trentaine de minutes.
L'Avenir Pinot Grigio Stellenbosch 2024, est disponible à la SAQ : code 15401296. Prix 14,95 $.
Roger Huet
Chroniqueur vins et spiritueux
LaMetropole.com
SamyRabbat.com


























